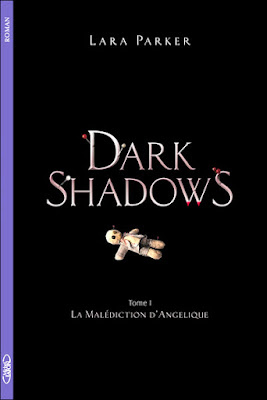Mercredi
(Wednesday)
Une série créée par Alfred Gough et Miles Millar, réalisée par Tim Burton d'après les personnages de C.Addams.
Avec : Jenna Ortega, Christina Ricci, Gwendoline Christie, Catherine Zeta-Jones, Luiz Guzman...
Date de diffusion sur Netflix : 23 novembre 2022.
A présent étudiante à la singulière Nevermore Academy, Wednesday Addams
tente de s'adapter auprès des autres élèves tout en enquêtant à la suite
d'une série de meurtres qui terrorise la ville...
***
Autant dire que l'annonce du projet il y a deux ans a ravi le cœur de nombreux fans à travers le monde : Tim Burton, enfin, adapte La famille Addams. L'idée n'est pas nouvelle, et pour cause : l'univers de Chas Addams a toujours semblé cousu main pour le célèbre réalisateur. Déjà à la fin des années 80, la transposition cinématographique des comics délicieusement macabres de Chas Addams lui avait été confié. Trop occupé par le tournage de Batman : le défi, Burton avait dû décliner l'offre et passer la main à Barry Sonnenfield. Ce dernier, depuis, s'est par ailleurs illustré dans plusieurs réalisations d'ambiance particulièrement burtonienne (en tête, les séries Pushing Daisies et Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire). Au début des années 2010, une nouvelle adaptation de La famille Addams signée Burton est annoncée, sous la forme d'une série en stop-motion (une méthode d'animation très prisée du créateur de L'étrange Noël de Mr Jack et des Noces funèbres) mais là encore, le projet ne voit pas le jour. Ce n'est finalement qu'en 2020 que l'adaptation se concrétise avec l'annonce de la série Mercredi (Wednesday), à la fois suite et spin-off centré sur l'aînée des enfants Addams...
Trailer de la série.
Pourquoi cette décision ? Burton a pu expliciter très clairement son choix, notamment lors d'une récente interview à Lyon, dans le cadre de la remise du Prix Lumière. Si l'univers de Chas Addams l'intéressait, il avait toujours été beaucoup plus captivé par le personnage de Mercredi que par le reste de la famille. Outsider gothique et cynique, Mercredi était d'après lui une âme sœur de fiction, une anti-héroïne à laquelle il pouvait pleinement s'identifier. Si l'on se penche sur la filmographie de Burton et ce qu'il a pu dire des personnages qu'il a porté à l'écran par le passé, on ne peut que remarquer cette constante : l'importance, pour le cinéaste, d'une identification porteuse de sens.
Le casting est longtemps resté secret, aussi les fans ont-ils pu spéculer à loisir quant à la potentielle distribution. Nombreux étaient ceux qui souhaitaient voir Christina Ricci (la Mercredi des films de Sonnenfield) revenir en Morticia, mais les paris se faisaient principalement sur un duo Johnny Depp / Eva Green pour incarner les iconiques parents Addams. Des acteurs burtoniens pour une série burtonienne, et autant de fantasmes propres à susciter l'enthousiasme des téléspectateurs. Finalement, l'annonce des interprètes définitifs a créé la surprise avec, dans le rôle de Morticia et Gomez, Catherine Zeta-Jones (absente des écrans depuis déjà quelques années) et Luiz Guzman (qu'on serait tenté de qualifier d'inconnu au bataillon, mais qui présente pourtant une filmographie impressionnante). Si la première a fini par convaincre le public, le second a davantage refroidi les fans des précédentes adaptations, arguant qu'il ne ressemblait ni à Raul Julia, ni à John Astin, (ses prédécesseurs dans le costume du patriarche des Addams). Mais comme l'a si bien souligné Burton lui-même, c'était cependant mal connaître les dessins originaux de Chas Addams, lesquels dépeignaient Gomez sous les traits d'un petit bonhomme assez hideux.
Passée la surprise, on doit reconnaître que le casting fait son office, d'autant que les autres membres du clan Addams ne font que de courtes apparitions au titre de guests. Catherine Zeta-Jones se révèle à l'écran être une Morticia particulièrement réussie et efficace, et ce bien que son interprétation, plus dans l'émotion, s'éloigne de celle (iconique) d'Angelica Huston et de celle (plus classique) de Carolyn Jones. Bien qu'elle ne revienne pas dans le rôle de Morticia que certains lui auraient volontiers donné, Christina Ricci fait un come back convaincant dans le rôle de Miss Thornhill, personnage peut-être d'ailleurs plus important que ne le laisse penser le scénario de prime abord. On retrouve également à l'affiche de cette version, dans le rôle d'un autre personnage inédit, l'excellente, imposante et charismatique Gwendoline Christie qui, comme à chacune de ses apparitions, crève l'écran.
Mais attardons-nous sur l'héroïne du jour : Mercredi, jouée ici par Jenna Ortega. Cette jeune comédienne particulièrement prometteuse qui s'est récemment faite remarquée dans le cinéma d'horreur porte en réalité toute la série sur ses épaules, avec un talent qui fait honneur à l'univers créé par Chas Addams. Si son jeu est une synthèse de toutes les précédentes interprétations du personnage, notamment dans la dimension physique (timbre de voix grave et monocorde, posture droite, démarche raide, aucun clignement des paupières face caméra...), elle lui donne une certaine profondeur et, en dépit des aspects archétypaux du rôle, apporte un réalisme tangible à la psychologie impulsée par Burton. Plus que la fillette blafarde au sarcasme aiguisé, Jenna Ortega fait passer Mercredi de gimmick gothico-caustique au rang de protagoniste totalement incarné. Sa langue acérée et son cerveau affuté en font une parfaite détective amateur dans cette histoire qui s'amuse à entremêler dark fantasy et polar, weirdo solitaire à l'intelligence atypique qui utilise ses étranges capacités pour lever le voile sur les mystères qu'elle croise. Son minois unique n'est d'ailleurs pas sans nous rappeler une sorcière à nattes du
petit écran : Fairuza Balk, actrice aux traits inoubliables qui jouait déjà les élèves en école de
sorcellerie dans Apprentie Sorcière (d'après les romans Amandine Malabul). Réinterpréter ici Mercredi en apprentie romancière mélomane adepte du parapluie-épée (on pense alors à Lili Goth, probablement une de ses lointaines cousines) fait également partie des ajouts plutôt bien pensés du scénario.
Si les critiques ont rendu un avis majoritairement positif, il tient justement pour beaucoup à l'interprétation de Jenna Ortega, sans qui, d'après Rotten Tomatoes, la série serait "aussi dramatique que les productions de la CW". On doit admettre que le reste de l'univers développé à l'écran n'est pas entièrement satisfaisant. Tout le sel de la famille Addams telle qu'inventée par Chas Addams tenait à la dichotomie entre le monde ordinaire, ses principes et ses codes sociaux d'un côté, et la façon d'être et de faire des Addams, aristocrates so dark aux étranges manies, de l'autre. Ce propos s'émousse complètement dans le postulat de base de la série de Burton, pourtant jusque-là assez doué pour jouer des clairs-obscurs : exclue de nombreux établissements scolaires, Mercredi est envoyée dans un pensionnat de monstres. Bizarre parmi les bizarres (et ce bien qu'elle sorte toujours du lot), elle n'illustre donc plus l'étrange au milieu de la normalité, si ce n'est que tous les autres monstres n'ont rien, au final, de très extraordinaire.
Outre cette impression (un peu déjà vue) d'assister à un un cross-over des Addams à Poudlard, la série nous a remémoré d'autres propos tenus par Burton lors du festival Lumière de Lyon : alors que lui-même était mis au banc de tout collectif à cause de son étrangeté, alors que ses premiers films de monstres étaient critiqués à cause de leur bizarrerie, les monstres et l'étrangeté sont aujourd'hui devenus à la mode. Burton ferait-il du conventionnel ? Déjà dans son Miss Peregrine et les enfants particuliers, des enfants "monstrueux" dotés de pouvoirs et de capacités extraordinaires, rejetés par les autres, se réunissaient en une nouvelle famille, une communauté. Peut-être cette Mercredi qui trouve sa place parmi ses semblables est-elle le reflet d'un Burton passé d'outsider du cinéma à moteur d'une mouvance aujourd'hui reconnue et appréciée. Il faut cependant quelques épisodes pour cerner le message du réalisateur et apprécier pleinement cette série qui, sans mal démarrer, souffre de la comparaison avec certaines de ses aînées.
En tête : Chilling adventures of Sabrina, la relecture horrifique de Sabrina l'apprentie sorcière, également adaptée par Netflix. Le thème de la différence, l'école de sorcellerie, la famille de parias macabres et les références à la culture et à la littérature gothique y abondaient déjà, avec un entêtement particulier du personnage principal, quitte à mettre son entourage en danger (sans oublier Bianca, reine des abeilles de la Nevermore Academy, quasi-sosie du personnage de Prudence Night). Comme Sabrina dans la série, Mercredi est tout à la fois remède et poison de l'aventure qu'elle se retrouve à vivre, mais aussi objet d'un enjeu qui la dépasse malgré sa conviction de maîtriser les tenants et aboutissants des événements. Heureusement, Burton ajoute une dimension policière bien menée (même si les plus rodés des téléspectateurs auront découvert le pot aux roses au premier tiers de la série), qui apporte une densité supplémentaire et qui nous rappelle notre bien-aimée Flavia de Luce.
Burton s'amuse à parsemer de nombreux clins d’œil et autres références tout au long de ces huit épisodes. La littérature gothique a bonne place, avec du Edgard Poe et du Mary Shelley à tout va (et on en redemande), mais aussi des easter eggs délicieusement shakespeariens, notamment avec la fontaine Ophelia (où une statue en bronze de la célèbre héroïne du dramaturge semble flotter à la surface de l'eau). Le village des pèlerins reconstitué non loin de l'école nous rappelle bien évidemment le film Les valeurs de la famille Addams ; la Nevermore Academy ressemble par ailleurs à une version augmentée du Manoir Addams, et on aperçoit furtivement un portrait du cousin Machin (étiqueté "Ignatus Itt") sur un mur de l'école. Le terrible spectre de Joseph Crackstone ressemble fortement au fantôme de Mr Boogedy, esprit vengeur d'un quaker qui a fait les belles heures de Disney à la télévision dans les années 80. La danse (déjà culte) de Mercredi lors du bal de promo, à mi-chemin entre les convulsions d'un possédé et un twist déjanté, nous remémore avec un plaisir coupable des pas du Time Wrap dans l'inoubliable Rocky Horror Picture Show ; bal de promo dont le final sanglant semble être un hommage totalement assumé à Carrie, héroïne de Stephen King. Enfin, Burton glisse également son iconique arbre mort dans la cour de l'école, tandis que le costume de chat de Mercredi se révèle très ressemblant à celui de sa Catwoman, jouée en son temps par Michèle Pfeiffer. Quant à la Chose, en digne créature de Burton, elle nous est présentée ici sous un jour très... couturé.
Danny Elfman rejoint une fois encore Burton en mettant en musique cette nouvelle réalisation de son comparse de toujours. Un chouette travail est effectué pour que les mélodies nous évoquent, sans jamais les plagier, le célèbre thème de La Famille Addams aujourd'hui indissociable de ces personnages (à l'image de la musique du générique, sujet aux souvenirs régressifs). Mais plus encore que les compositions originales, c'est la réinterprétation d’œuvres connues et le mélange des genres qui rendent la bande-son de Mercredi unique : Edith Piaf, Vivaldi, mais surtout Paint it black des Rolling Stones au violoncelle. Un mélange entraînant et explosif.
Générique de la série.
En bref : Si Mercredi pourrait presque tomber dans le conventionnel, la série se bonifie heureusement au fil des épisodes, notamment grâce à son amusant mélange des genres et à sa dimension policière bien menée. On retrouve dans le ton des dialogues, ciselés au sarcasme, la frontière poreuse entre premier et second degré, caractéristique de l'humour de Chas Addams. Mais surtout, la série est intégralement portée par Jenna Ortega, rôle titre impeccable. On passe finalement un bon moment et on espère vivement retrouver cette Mercredi dans une seconde saison !
Pour patienter jusqu'à la saison 2 : un petit cours de danse made in Wednesday !